Un village remplit…
Histoire & Patrimoine
De la Préhistoire à l’époque Gallo-Romaine
Le lieu est occupé dès la Préhistoire, comme l’atteste la découverte de nombreux silex taillés et pierres polies sur le territoire de la commune.
Les véliocasses, peuple gaulois de la région, se sédentarisent et développent l’agriculture. Puis les romains occupent le territoire. Deux sites d’habitat et un atelier de potier de l’époque gallo-romaine datant du IIème siècle sont découverts.
Du Vème siècle à la guerre de 100 ans.
Les Francs, entre le Vème et le VIIème siècle, envahissent le Vexin et s’y fixent, accaparant les domaines gallo-romains.
Les Normands, pillent la région à plusieurs reprises, jusqu’à ce que la paix soit conclue en 911 par le Traité de Saint-Clair-sur-Epte.
Les populations chassées dans les forêts par les envahisseurs, reviennent construire leurs habitations et Haravilliers, comme tout le Vexin, connaît alors une ère de paix et de prospérité qui dure jusqu’à la Guerre de Cent Ans. Cette population agricole cultive des céréales, blé, orge et avoine, fourrages pour l’élevage ansi que des plantes textiles. La vigne est aussi cultivée au Ruel comme à Haravilliers, et des légumineuses, vesces, pois et fèves.
La dimension de l’église indique l’importance de la paroisse au Moyen Âge.
A partir du XV ème siècle
Au milieu du XVIème siècle, les ruines laissées par la Guerre de Cent Ans sont réparées. La population retrouve le niveau atteint au XIVème siècle. Dans son recueil des Antiquités et singularités de la ville de Pontoise, le moine Noël Taillepied (1540/1589) précise que : le pays de Velquecin a chair et poisson, terre et eau, bleds et vignes, bois et prés, étangs et rivières, petites montages et doulces vallées, chaux et plastre, pierres et briques, villes et châteaux, nobles et paysans, hommes en grand nombre et plusieurs espèces d’animaux ; bref, il n’y a pays au monde plus commode à l’entretennement de la vie humaine, tant pour la sérénité de l’air que pour l’abondance des vivres qui y sont quand il court bon temps.
Cette période faste est interrompue par les Guerres de Religion qui sement à nouveau terreur et désolation.
Du XVIème siècle au XVIIIème siècle, après la victoire du roi Henri IV (1553/1610), le Vexin se reconstruit. Les villages sont rebâtis, malgré les épidémies successives de Peste et les mauvaises récoltes dues aux catastrophes naturelles.
Patrimoine
Le village compte plusieurs vieilles maisons rurales, architecture typique du Vexin Français, réalisées en moellons, pierres, briques et tuiles. Des pierres de taille lui servent de chaînes d’angle, le toit est en tuiles et les cheminées en briques.
L’église Notre-Dame de l’Assomption
De dimensions généreuses par rapport à l’importance du village, elle se distingue par son haut clocher-tour précédant la façade méridionale. L’élément le plus remarquable est la tourelle d’escalier romane à l’angle Sud-Ouest de l’édifice, coiffé par un lanternon richement décoré. Les différentes parties de l’église réunissent des éléments provenant d’époques différentes.
La façade occidentale (sauf le portail) et le collatéral Sud, parties les plus anciennes, sont romanes et datent du milieu du XIIème siècle.
L’église est agrandie au siècle suivant, époque à laquelle remonte le croisillon Nord du transept qui a disparu aujourd’hui.
A l’origine, elle doit être de plan cruciforme conventionnel avec un clocher central.
Plus...
Au XIVème siècle, le chœur et son collatéral sont remaniés.
Au XVème siècle, comme dans la plupart des communes du Vexin Français, la Guerre de Cent Ans occasionne d’importants dégâts et probablement la destruction du clocher central primitif car vers la fin du siècle, le clocher actuel est édifié.
Au XVIème siècle, la nef et le collatéral Nord sont remaniés et toutes les voûtes refaites. Une grande chapelle de deux travées est ajoutée au Nord du chœur, affichant le style Renaissance.
L’édifice est classé au titre des Monuments Historiques en 1915. Six éléments de mobilier sont également classés au titre d’objet : un groupe sculpté en pierre, représentant une Vierge de Pitié, du XVème siècle ; une statuette en pierre de saint Roch, du XVIème siècle ; une statue en pierre polychrome de la Vierge à l’Enfant, de la fin duXVIIème siècle ; une statue en pierre polychrome de Joseph, du XVIIème siècle ; le maître-autel, portant un tabernacle à porte convexe, flanqué de deux ailes concaves, avec le retable majeur, ensemble en bois taillé et stuc du premier quart du XVIIIème siècle ; la dalle funéraire à effigie gravée de Bartholomé N…, curé d’Haravilliers, mort en 1366.
Un groupe sculpté représentant l’Éducation de la Vierge par sainte Anne du XVème siècle, est volé en 1964.
Avant sa fermeture au public car en 1992, l’église présente des dommages de plus en plus importants et menace de s’effondrer. Des travaux sont effectués en plusieurs tranches et l’église sauvée est réouverte aux offices. En 1997, Karol Wojtyla, pape Jean Paul II (1920/2005) est invité par le maire de la commune, Marc Vignal, à y venir célébrer une messe lors de sa visite en France.
Le colombier
Situé dans un champ à l’Est de l’église, il est le dernier vestige d’une ferme seigneuriale à cour carrée, du XVIème siècle, qui figure sur un plan terrier de 1722.
Bâti en forme de tour cylindrique à toiture conique, il est divisé en deux étages. Le soubassement est formé de deux rangées de grandes pierres d’appareil, le reste de la construction est en blocage de grès enduit au plâtre avec chaînes de pierre. Le côté Ouest est percé de trois ouvertures, situées l’une au-dessus de l’autre en arc segmentaire appareillé. La façade comporte une corniche, un bandeau et des encadrements de baie en pierres de taille. La toiture conique est rénovée au XXème siècle. La couverture est en tuiles plates.
Plus...
Dans la salle basse, un pilier central porte une voûte annulaire à huit chaînes de pierre. Une petite ouverture surmontée d’une fenêtre permet l’accès à la salle haute mais le plancher intermédiaire n’existe plus ; il subsiste quelques traces des boulins disparus dans la maçonnerie. La charpente en chêne est composée d’une enrayure basse, d’une enrayure haute, d’un poinçon et de chevrons-formant-fermes.
Il porte, grossièrement gravés sur un côté, la date de 1789 et un nom, sans doute celui du couvreur ayant effectué une restauration précédente.
Il est inscrit aux Monuments Historiques en 1978.
La chapelle Sainte-Marie-Madeleine
Selon le Pouillé de Rouen de 1738, elle est unie au prieuré de Saint-Nicolas de Rosnel. Sa construction rectangulaire très élémentaire, en moellons appareillés, sans caractère de structure ou de décoration ne permet pas une datation précise. Le choeur, partie la plus ancienne, semble du début du XIIIème siècle. La nef est remaniée au XVIème et au XVIIème siècle. La charpente en carêne peut être du XVIème siècle. Les arbalétriers courbes sont dissimulés sous un lambris plâtré. Elle est couverte d’un toit de tuiles à double versant.

Plus ...
A l’angle Nord-Est, le choeur conserve deux contreforts à un seul talus, jumelés perpendiculairement, du XIIIème siècle, tout comme la baie d’angle du pignon en cintre surbaissé. La porte et la baie en arc segmentaire du pignon Ouest appartiennent aux modifications effectuées au XVIIIéme siècle. Le choeur de pierres appareillées est un peu plus étroit et plus bas que la nef. Il est voûté, en berceau brisé très aplati, .
Dans le mur Sud, s’ouvrent une piscine en plein cintre, à deux cuvettes et une armoire carrée ayant probablement servie de réserve eucharistique ou de rangement pour les vases sacrés. Les vitraux sont d’Olivier Juteau (1955/-), maître verrier, et datent de 1962.
La chapelle est dédiée à la femme pécheresse qui parfume les pieds du Christ et assiste à sa Passion.
Ce type d’édifice sont autant de manifestations de la piété populaire. Par leur construction, les croyants cherchent à s’assurer la protection de saints ou martyrs, notamment face aux éléments naturels.
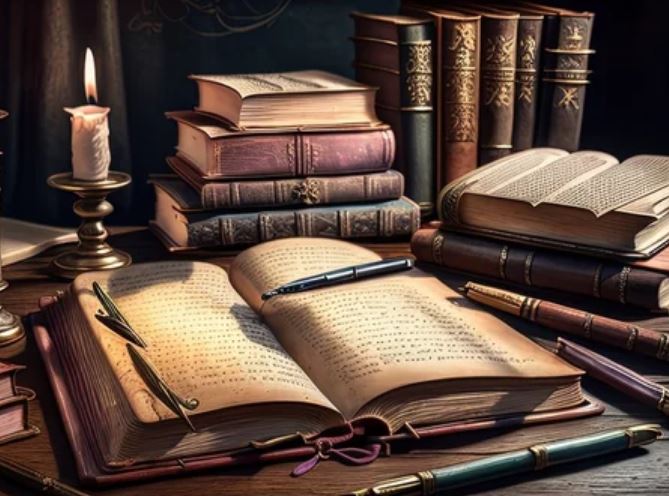
Histoires courtes
Intrigues et faits marquants








